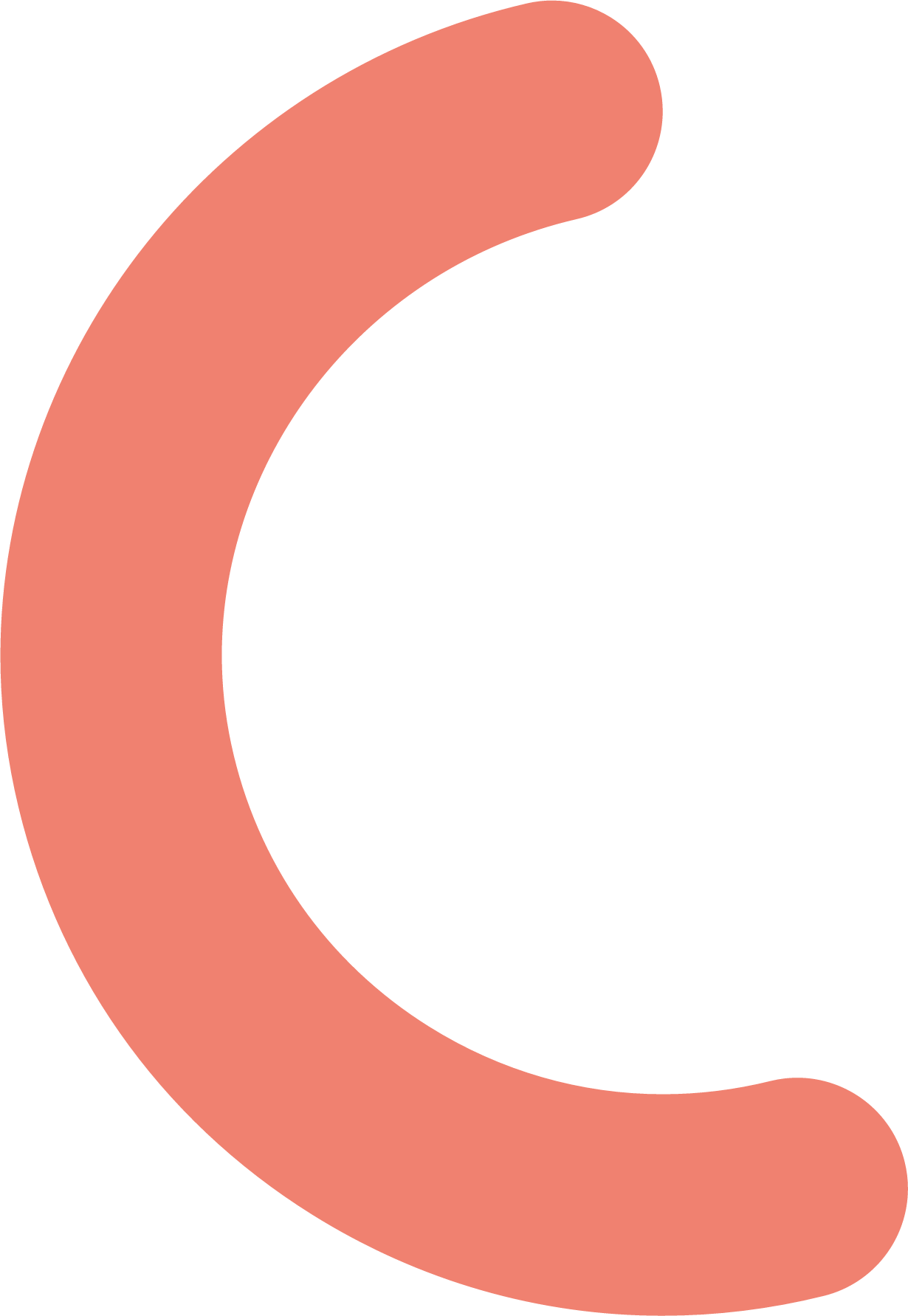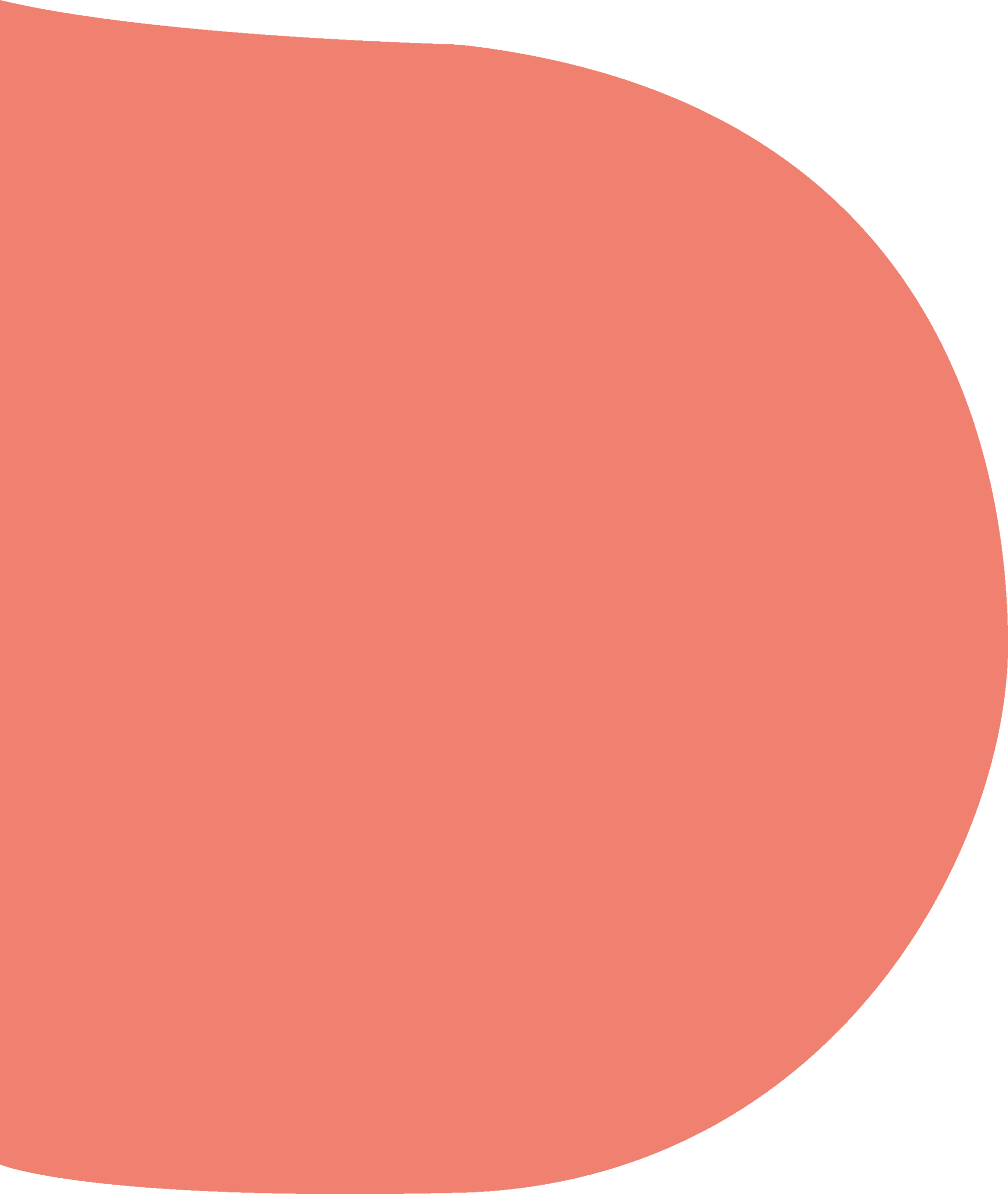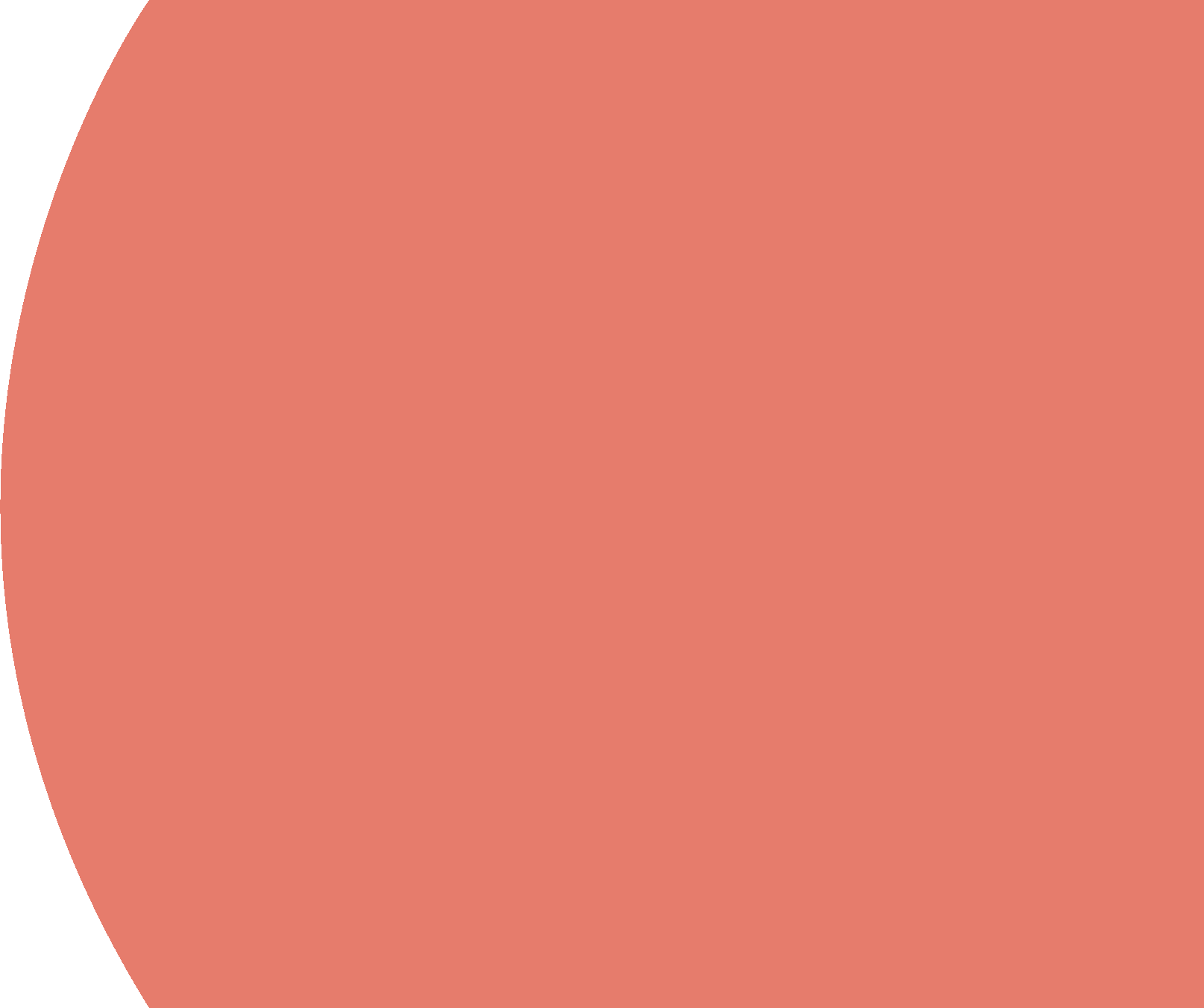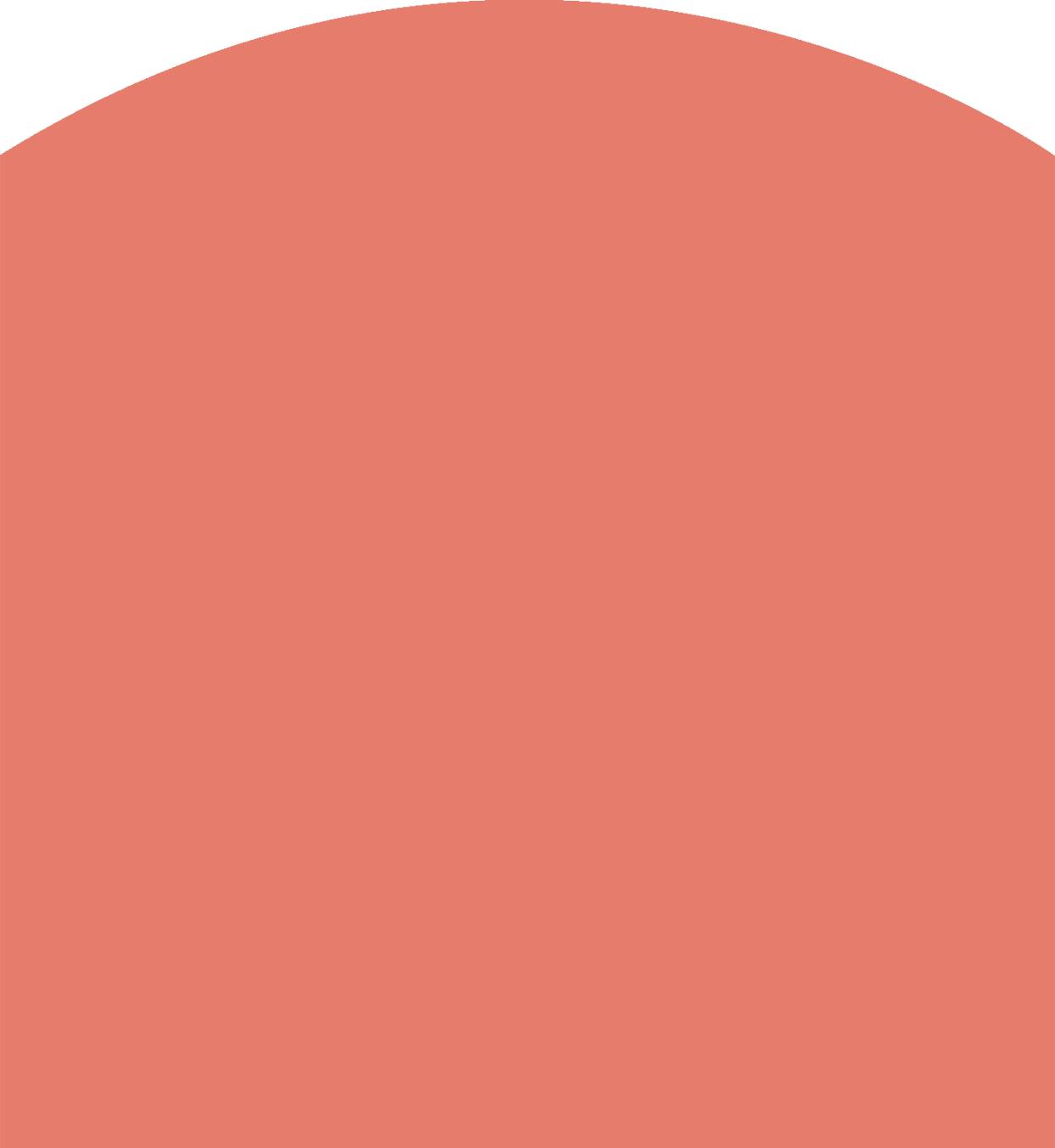Détaillons ensemble un concept à intégrer dans nos uses et coutumes
Interview avec Camille Kerneguez, co-fondatrice et vice-présidente de Dear Valid People. Interview d’Audrey Nicoulaud.
Audrey : Est-ce-que tu veux bien te présenter ?
Camille : Je m’appelle Camille, j’ai 30 ans. Je travaille dans la gestion de projet au sein d’une collectivité, autour des questions de handicap, d’accessibilité et d’inclusion. À côté de cela, je suis vice-présidente de l’association Dear Valid People, que nous avons fondée en 2023.
Camille : De manière simplifiée, le validisme, c’est le fait de vivre dans une société conçue par et pour des personnes valides. C’est un système d’oppression qui exclut ou isole les personnes handicapées, ou toute personne qui ne correspond pas à une norme de validité. Au Canada, c’est le terme de “capacitisme” qui est employé. Intéressant aussi, ce sont des natures un peu différentes de voir les choses.
Mais le validisme, ce n’est pas juste “ne pas aimer les personnes handicapées”. Souvent, on peut restreindre la pensée à “En fait, on n’aime pas les personnes handicapées, du coup, on les exclue” mais ce n’est pas forcément question de ça. C’est plutôt que tous les lieux et toutes les informations ne pas accessibles, notamment pour les personnes qui ne parlent pas la même mangue ou le même langage ou de la même façon. En effet, ce terme, c’est aussi la question de l’accès aux informations et des compensations du handicap qui sont nécessaires, et tout cela, dans tous les secteurs de la vie.
C’est un terme que j’ai découvert récemment, dans le milieu militant. Il permet de nommer toutes ces micro-agressions quotidiennes que subissent les personnes handicapées, fréquemment banalisées : des phrases comme “ah, à ta place, si j’étais dans cette situation, je me suiciderais”, “Ça passe, parce que finalement, tu es mignonne”, celui-là, on est sur un biais sexiste aussi, l’enfer ! Ou encore “C’est quand même bien ce que tu fais pour une personne handicapée”. On est vraiment sur des petites agressions constantes issues d’une vision validiste des choses qui rentrent progressivement dans le langage ordinaire.
Plus largement, le système validiste est un système qui ne fonctionne pas : il prétend s’adresser à la majorité, mais ne répond qu’aux besoins d’une minorité. Il fonctionne pour une minorité de la population qu’on croit être une majorité. Sauf que, à partir du moment où tu nais sur cette planète, tu vas vieillir et peut-être à un moment donné, tu vas te retrouver dans une situation de handicap. Et ça, tout le monde a tendance un peu à l’oublier. On se dit que quand on est valide, on va forcément terminer valide. Ainsi, tout ce qui est de l’ordre de l’accessibilité sont des questions qui ne nous importent pas. L’ONU rappelle que dans les pays où l’espérance de vie dépasse 75 ans, chaque individu passera en moyenne entre 8 et 10 ans en situation de handicap. Je trouve que c’est une moyenne assez parlante.
Audrey : On parle ici du handicap au sens large, c’est-à-dire, tout besoin particulier chez une personne ?
Camille : Oui, complètement. Le validisme englobe toute forme de handicap, diagnostiqué ou ressenti. On ne se limite pas au modèle médical : on parle aussi d’approche sociale et de rapport aux choses et aux gens. À partir du moment où une personne ressent une limitation — physique, mentale, psychique, cognitive ou autre, il y a un système validiste dans lequel elle s’inscrit.
Et il ne faut pas oublier que 80 % des handicaps sont invisibles. Pour les personnes atteintes de maladies chroniques, par exemple, que vous accompagnez dans votre travail, la question de la réinsertion professionnelle ou sociale doit être pensée autrement. Et cette réinsertion n’est pas possible de la même façon qu’une personne valide.
Il faut se demander comment est-ce que ce système-là implique, intègre des personnes qui, on va dire, ont des besoins ou en tout cas un besoin d’accès différent.
Il y a beaucoup de travail à différents niveaux, localement, comme à Montpellier, et nationalement. Après, dans une certaine mesure, quand tu prends le verre à moitié plein, on se dit que, bon, à Montpellier, on n’est pas si mal lotis par rapport à d’autres villes (Paris, juste pour la citer).
Camille : Il y a encore beaucoup de travail, à la fois au niveau local et national. À Montpellier, par exemple, on est plutôt bien lotis par rapport à d’autres villes, comme Paris.
Je suis originaire de région parisienne, j’ai étudié à Nantes, vécu au Cambodge en service civique, et je suis aujourd’hui à Montpellier. Je suis en fauteuil roulant, même si je peux marcher un peu. J’ai donc toujours connu la vie avec un handicap, et je peux dire que la réalité est très différente d’une ville à une autre et encore plus d’un pays à un autre.
Audrey : Et en Espagne, par exemple ? J’ai l’impression que c’est beaucoup plus accessible.
Camille : Oui, totalement. Là-bas, la présence des personnes handicapées dans l’espace public est ordinaire. Les infrastructures sont pensées pour elles. Elles font pleinement partie de la société, sans que cela soit remis en question à chaque fois.
Rien qu’au niveau de l’accès aux plages, les différences sont frappantes : rampes d’accès, fauteuils adaptés à la baignade, etc. À Valence, j’ai même vu des rampes artisanales, pas forcément aux normes, mais fonctionnelles ! En France, on a perdu cette débrouillardise. Ici, c’est souvent : soit parfait, soit pas fait.
Et en plus, la norme technique a fini par remplacer l’aide humaine. Sous prétexte que les lieux sont “accessibles”, on estime qu’il n’y a plus besoin d’aide ou de solidarité. C’est une vision très individualiste, que je trouve dommage.
Audrey : Éviter le sujet, ce serait donc renforcer la situation de handicap ?
Camille : Oui, tout à fait. Cela renforce surtout l’invisibilisation. Et l’invisibilisation est néfaste. Il ne s’agit pas de mettre les personnes handicapées constamment sous les projecteurs, mais simplement de leur laisser une place normale.
Dans les représentations médiatiques, on tombe souvent dans deux extrêmes :
Soit la personne handicapée est présentée comme une victime qu’il faut sauver — héritage de la charité chrétienne.
Soit elle est glorifiée dans ce qu’on appelle le porno inspirationnel (concept de la sociologue australienne Stella Young), où on l’admire simplement parce qu’elle “réussit malgré son handicap”.
Mais un athlète paralympique, par exemple, n’est pas “incroyable parce qu’il est handicapé” : il l’est parce qu’il est athlète, parce qu’il s’entraîne, s’investit et surmonte des difficultés concrètes. C’est ce regard-là qu’il faut changer.
Il y a souvent un manque de prise en compte des “coulisses” du handicap : la fatigue, la gestion de l’énergie, les adaptations invisibles. On pense que tout est réglé dès qu’il y a un ascenseur.
Et puis, il y a cette ambivalence : en tant que personne handicapée, tu veux prouver que tu peux “faire comme tout le monde”, mais à quel prix ? Cette tension est épuisante, d’autant qu’on évolue dans une société capitaliste et productiviste où l’efficacité reste la valeur dominante.
Audrey : Quelles seraient, selon toi, les pistes pour limiter le validisme et favoriser une inclusion réelle ?
Camille : D’abord, il faudrait que la loi de 2005 soit réellement appliquée, et que tous les établissements recevant du public soient accessibles. Cela éviterait aux personnes handicapées de devoir se demander si elles pourront, ou non, accéder à un lieu.
Ensuite, il faut miser sur la formation, la sensibilisation, et l’acculturation. Mais aussi sur la représentation : que des personnes handicapées soient à des postes décisionnels. Rien ne peut se faire sans elles. Si on attend toujours que “les autres” aient de l’empathie pour agir, rien ne bouge.
Audrey : Peux-tu nous parler de vos actions avec Dear Valid People ?
Camille : L’association est basée à Montpellier. Nous organisons tous les deux mois des conférences à la Gazette Café, ainsi que dans d’autres lieux du quartier Généreux. Nous lançons aussi des cercles de parole, notamment dans les Maisons pour Tous, pour favoriser des échanges plus intimes, de pair à pair.
Toutes nos conférences sont enregistrées et disponibles en podcast sur YouTube et les plateformes d’écoute. On y aborde des thèmes variés : écologie et handicap, féminisme, rapport au travail, au couple, etc.
Nous avons également organisé en juin 2024 le premier Handi Fest, un festival 100 % inclusif aux Halles Tropisme. Il rassemblait conférences, ateliers, stand-up et concert. C’était un moment de fête et de joie, accessible à tous. Nous prévoyons une deuxième édition en 2027.
Le bureau de l’association compte deux personnes en situation de handicap. Cela implique une gestion différente du temps et de l’énergie, d’où l’importance de mobiliser davantage de personnes — valides ou non — autour de nous.
Enfin, nous voulons développer des partenariats avec d’autres structures et artistes qui parlent du handicap, afin de valoriser ces démarches, qu’elles soient artistiques ou sportives.
Audrey : As-tu des ressources à recommander pour aller plus loin ?
Camille : Oui, un documentaire essentiel : Crip Camp, disponible sur Netflix et YouTube. C’est une référence dans le milieu militant et antivalidiste.
Et un livre très fort : Plutôt vivre de Chiara Kahn et Charlotte Puiseux.
Audrey : Merci beaucoup pour cet échange et pour ces ressources !
Camille : Avec plaisir, merci à toi !